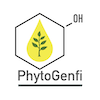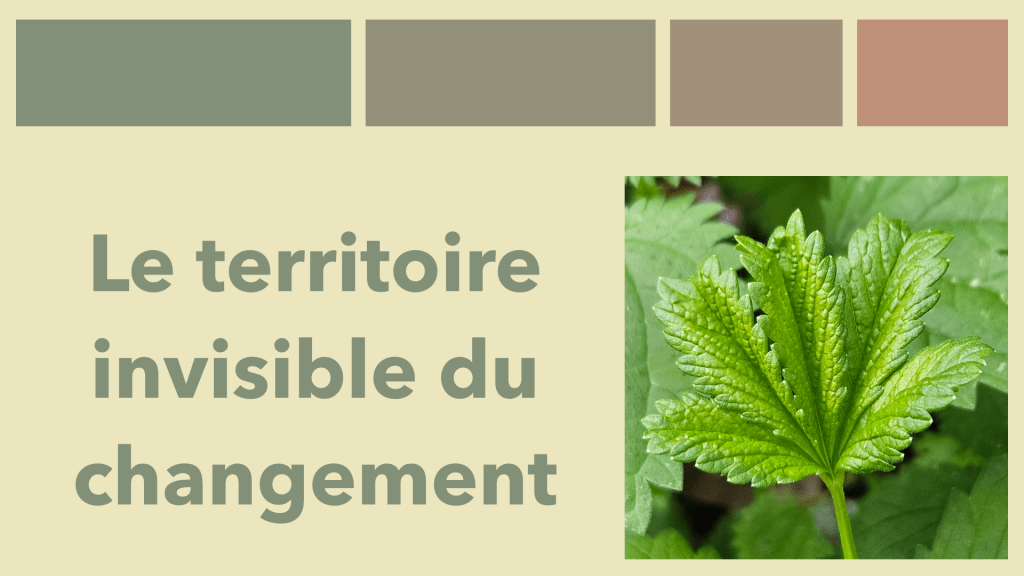
On parle souvent de libre arbitre comme d’une simple capacité à choisir. Mais cette définition est pauvre. Le libre arbitre, dans son sens le plus profond, n’est pas l’aptitude à choisir entre le thé et le café, c’est l’intention de se sculpter soi-même. C’est la force paradoxale qui nous permet de nous détourner d’un optimum biologique immédiat, d’ignorer la voie de la facilité pour affirmer la primauté de la conscience sur l’instinct.
La neuroplasticité, de son côté, est la promesse biologique faite à cette intention. C’est la reconnaissance scientifique que le cerveau n’est pas une pierre gravée, mais une argile vivante, capable de tracer de nouveaux chemins, de défaire d’anciennes routes. Elle est le mécanisme potentiel qui attend l’impulsion de l’architecte.
Mais entre l’architecte et l’argile, entre l’intention pure et le mécanisme disponible, s’étend un espace immense, un territoire d’ombres que l’on traverse rarement sans peine. C’est là que se cache tout ce que l’on ne voit pas.
La première chose que l’on ne voit pas, c’est le champ de bataille. Nous imaginons l’intention agissant dans le calme d’un atelier, alors qu’elle doit se frayer un chemin dans le vacarme assourdissant de notre époque. Le cerveau, saturé par un déluge informationnel, baisse les bras. Il ne cherche plus à créer, mais à survivre. Face à ce brouillard cognitif, le libre arbitre a besoin d’un allié : une méthode. Une stratégie consciente pour ériger des boucliers, pour défendre l’attention et la rediriger. Sans cette discipline, l’intention la plus forte se dissout avant même d’avoir atteint l’argile.
Ensuite, même avec une méthode, on ne voit pas l’origine de l’étincelle primordiale. D’où vient la force qui initie le tout premier pas, celui qui brise l’inertie ? On croit à tort qu’il s’agit de volonté pure, mais c’est une force plus primitive, plus viscérale. Parfois, elle naît de l’impact contre un mur, lorsque la douleur du présent devient si intolérable que la peur du changement s’efface. La force n’est pas désir, elle est rejet. D’autres fois, elle jaillit d’un éclair, d’une vision si claire et si désirable de ce que l’on pourrait être qu’elle nous tire hors de nous-mêmes. Cette énergie d’activation, on ne la décrète pas. Elle émerge de nos blessures ou de nos rêves les plus profonds.
Enfin, et c’est la chose la plus difficile à voir, on ne voit pas la nature du terrain sur lequel chaque personne se tient. Nous jugeons la course sans voir la pente. Pour certains, initier le changement, c’est marcher sur un chemin plat et dégagé. Pour d’autres, c’est tenter d’escalader une falaise boueuse, en pleine tempête. Ce terrain invisible est fait de notre neurologie, de la chimie de notre cerveau parfois appauvrie par la dépression. Il est façonné par les cicatrices du passé, par cette impuissance apprise qui murmure à l’âme que tout effort est vain. Il est conditionné par notre écosystème, la précarité qui dévore toute l’énergie mentale, l’isolement qui éteint la plus petite lueur d’espoir.
Alors non, l’espace entre la volonté de changer et le changement lui-même n’est pas vide. Il est peuplé de nos combats silencieux, de nos ressources cachées et de nos fardeaux invisibles. Peut-être que le premier acte de changement, le plus puissant de tous, n’est pas de faire un pas en avant, mais d’arrêter de se flageller en regardant les autres. Comprendre que son terrain est unique, que ses armes sont différentes, c’est s’offrir enfin la permission de mener son propre combat, à son propre rythme. La véritable force ne naît pas en enviant la course des autres, mais en faisant la paix avec la sienne.